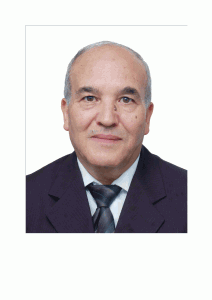Le gouvernement algérien vient de maintenir la règle des 49/51% pour tous les secteurs stratégiques et non stratégiques maintenant ainsi le statut quo, l’Algérie étant en transition depuis 1986, ni une économie étatisée, ni une économie de marché concurrentielle n'expliquant les difficultés de régulation économique, sociale et politique. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement où chaque pays veut attirer le maximum d’investisseurs et l’erreur de la mentalité bureaucratique est de croire que l’Algérie vit seule dans un désert. Rappelons que cette règle avait été adoptée au moment de la crise financière mondiale d’octobre 2008. Le maintien de cette règle peut-il être un frein aux investisseurs étrangers hors hydrocarbures, objet de cette contribution.
1.- Une économie sous perfusion de la rente
Après 50 années d’indépendance politique, l’économie algérienne est une économie totalement rentière, tertiaire (83% du tissu économique commerce est constitué des petits services selon l’ONS). Plus de 90% du tissu industriel est constitué de PMI/PME organisées sur des structures familiales. On peut démontrer facilement que le taux de croissance officiel hors hydrocarbures, de 5/6%, a été permis pour 80% par la dépense publique via les hydrocarbures. En 2012, Sonatrach c’est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach. 98% d’exportation d’hydrocarbures à l'état brut et semi brut (gaz et pétrole) et important 70-75% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées dont le taux d’intégration ne dépasse pas 15% après 50 années d’indépendance politique.
Sonatrach a engrangé selon les bilans financiers de Sonatrach de 2000 à juin 2012, 560 milliards de dollars et allant vers 600 milliards de dollars fin 2012. Cela a permis d’augmenter les réserves de change estimées à 56 milliards de dollars en 2005, 77,78 milliards en 2006, 110 milliards en 2007 à 138,35 milliards de dollars en 2008, à 147,2 milliards en 2009, à 157 milliards de dollars fin 2010, 188 milliards de dollars fin 2011 et allant vers 200 milliards de dollars fin 2012 et essentiellement grâce à la rente des hydrocarbures.
Cette richesse virtuelle alimente la dépense publiques devant différencier pour ce cas la part devises et la part dinars (les salaires étant versés en dinars). Pour la période récente de 2000 à 2014, elle est passée successivement de 55 milliards de dollars en 2004, à 100 milliards de dollars en 2005 puis à 140 milliards de dollars fin 2006 et qui a été clôturée entre 2004/2009 à 200 milliards de dollars, mais faute de bilan on ne sait pas si l’intégralité de ce montant a été dépensé.
Quant au programme d’investissements publics 2010/2014, le gouvernement a retenu des engagements financiers de l’ordre de 286 milliards de dollars) et concerne deux volets, à savoir le parachèvement des grands projets déjà entamés entre 2004/2009, l’équivalent de 130 milliards de dollars (46%) et l’engagement de projets nouveaux pour un montant de 156 milliards de dollars. Il n’existe pas de proportionnalité entre cette importante dépense publique et les impacts économiques, le taux de croissance 2000/2011 n’ayant pas dépassé en moyenne 3% alors qu’il aurait dû être plus de 10%.
La rente toujours la rente avec la hantise de l’épuisement. C’est dans ce cadre qu’ont été proposés les amendements de la nouvelle mouture. La loi des hydrocarbures attribue à l’entreprise nationale Sonatrach le droit exclusif en matière de transport d’hydrocarbures par canalisations et lui garantit la majorité dans les partenariats, aussi bien dans la production que dans la transformation des hydrocarbures. Seule nouveauté de la loi comme je l’ai précisé dans une interview à l’agence Chine Nouvelle, le 22 septembre 2012 , la modification de la taxation des superprofits au-delà de 30 dollars dans l’actuelle loi qui ne répondait plus à la situation actuelle du marché où le cours dépasse les 90/100 dollars depuis plus de deux années.
L’annonce d’un assouplissement fiscal était nécessaire, l’Algérie n’étant pas seule sur le marché mondial face aux importantes mutations énergétiques qui s’annoncent, mais des concurrents qui veulent attirer les compagnies. Ces dégrèvements de taxes ne s’appliquant qu’aux nouveaux gisements et non aux exploitation actuelles, posant d’ailleurs le problème du dualisme fiscal pouvant décourager ceux qui opèrent déjà. Qu’en est-il de la règle des 49/51% ?
2. La règle des 49/51% correspond t- elle à une logique économique ?
La nouvelle loi des hydrocarbures maintient la règle des 51-49%. Si pour l’amont gazier et pétrolier pour les grands gisements la règle des 49/51% peut être applicable, pour les gisements marginaux, cette règle risque de n’attirer que peu d’investisseurs sérieux. La non soumission des grandes compagnies, l’expérience du retrait de la Chine au niveau de la raffinerie d’Adrar, Sonatrach supportant toute seule dorénavant les surcoûts doit être méditée. Egalement, il ne faut pas s’attendre à un flux d’investissement étranger avec la règle des 49/51% pour la prospection dans l’offshore et surtout le gaz non conventionnel (réserves prouvées selon le rapport de l’AIE de 2011, 6500 milliards mètres cubes gazeux) qui requiert des techniques de pointe à travers le forage horizontal maîtrisé par quelques firmes.
D’ailleurs, en Algérie un débat national s’impose du fait des risques de pollution des nappes phréatiques au Sud du pays, un milliard de mètres cubes gazeux nécessitant 1 million de mètres cubes d’eau douce, sans compter la durée courte de la vie de ces gisements environ 5 années dont 20% de récupération contre 85% pour le gaz conventionnel et 600 puits moyens pour un milliard de mètres cubes gazeux et les confits avec des pays riverains se partageant cette nappe dont le Maroc, la Libye et la Tunisie.
La règle de 49/51% pose problème pour l’investissement dans la pétrochimie, dont la commercialisation est contrôlée par quelques firmes au niveau mondial, cette règle juridique de la dominance de Sonatrach dans le capital social est inopérante. Sans risque de me tromper, l’investissement sera limité pour ne pas dire nul avec cette règle. Cette filière nécessite pour sa rentabilité de grandes capacités, sans compter que les pays du Golfe ont déjà amorti les installations, l’Algérie partant avec un handicap des coûts d’amortissement élevés et un marché forcément limité.
Elle concerne également les énergies renouvelables dont un conseil des ministres en 2011 a prévu un programme qui vise à produire, à l’horizon 2030, 40% de l’électricité à partir des énergies renouvelables devant se traduire par l’installation d’une puissance de 12.000 mégawatts en solaire et en éolien. Ajouté au prix de cession du KWH qui couvre à peine les frais de production, expliquant en partie le déficit de Sonelgaz , aucun investisseur étranger ne viendra rendant caduque la loi sur le gaz et les canalisations.
Mais la règle des 49/51% ne concerne pas que Sonatrach mais l’ensemble des autres secteurs. Les lois de finances complémentaires 2009/2010 ont profondément modifié le cadre juridique régissant l’investissement surtout étranger. Concernant l’encadrement de l’investissement étranger dans les services, BTPH et industries y compris les hydrocarbures le privé étranger doit avoir au maximum 49% et le local 51% .Lors du Conseil des Ministres du 25 aout 2010, ces mesures ont été étendues aux banques étrangères complétant l'ordonnance n° 03-11 du 26 Août 2003, relative à la monnaie et au crédit.
Si ces mesures permettent de relancer l’outil de production, cela serait une bonne chose mais dans un environnement concurrentiel, se renforcer sur soi étant une utopie néfaste. Au cours de conférences internationales, mes contacts avec bon nombre d’opérateurs étrangers (USA-Europe, Asie, monde arabe notamment) montrent que dans la majorité des cas les investisseurs sérieux sont réticents à la venue en Algérie avec cette règle restrictive qui ne répond plus à de l’idéologie qu’à à la logique économique.
A moins que l’Algérie supporte les surcoûts pour des investissements de prestige non rentables économiquement ou comme elle a supporté plus de 50 milliards de dollars d’assainissement des entreprises publiques entre 1971/2011 dont 70% sont revenues à la case de départ. La règle du gouvernement algérien des 49/51% a pour fondement l’idéologie et non l’efficacité économique. Et l’erreur est d’avoir codifié cette règle dans une loi ne laissant plus de marges de manœuvres et créant des polémiques inutiles au niveau international, nuisibles à l’image de l’Algérie.
L’Etat algérien étant souverain, une décision au conseil des ministres aurait suffi pour distinguer les projets où l’on pourrait appliquer la règle de s49/51% des autres projets non stratégiques. Ne serait-il pas souhaitable d’avoir d’autres critères : balance devises excédentaire au profit de l’Algérie, l’apport technologique et managérial et un partage des risques ? L’objectif stratégique pour l’Algérie, au moment où dans moins de 15 ans l’Algérie sera sans pétrole et 25 ans sans gaz conventionnel, la population algérienne sera de 50 millions, comment réaliser la transition d’une économie de rente à une économie hors hydrocarbures au sein de la mondialisation. Or cette règle selon mon point de vue, généralisée à tous les secteurs est un obstacle majeur aux investisseurs soucieux d’investir à moyen terme et de contribuer à la croissance réelle.
Professeur des universités expert international Dr Abderrahmane MEBTOUL